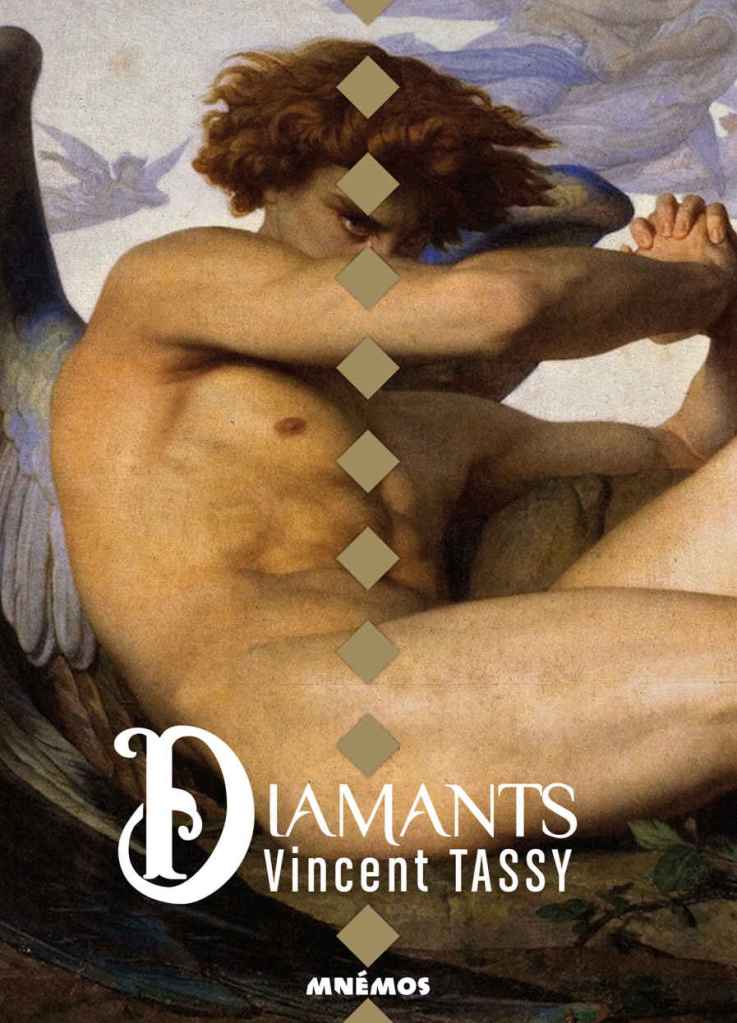Résumé : Un journaliste en quête d’un nouveau reportage devient malgré lui l’unique témoin du suicide d’une jeune actrice de X. Embarqué dans les bas-fonds de New York à la poursuite d’une mystérieuse « tribu » de goths grimés en vampires qui saignent et violent des femmes, il décide de mener l’enquête tout seul. Problème : sa femme est officier de police, et il ne tarde pas à découvrir que les films de snuff tournés par les « vampires » ne le laissent pas indifférent…
C’est mon premier Maxime Chattam. Il faut un début à tout ! À Noël, je me suis frottée à Musso, puis j’ai entamé un marathon Dan Simmons. Pour rester dans le thème « auteurs de best-sellers » (de préférence horrifiques), voici un thriller signé Chattam, le plus américain des auteurs français. J’en avais déjà entendu parler et je n’ai pas été déçue : comme tous les bouquins concoctés par des romanciers qui vendent (très) bien, celui-ci se dévore plus qu’il ne se lit. Le manque de consistance des personnages (je ne me souviens même plus du nom du protagoniste alors que j’ai fini le bouquin il y a une heure, c’est pour dire), l’écriture dépouillée et l’abus de de phrases nominales y sont pour beaucoup. De trop nombreuses coquilles, des anglicismes (« insane », « cure »…) et autres partis-pris orthographiques (« crads »), ou encore des dialogues peu crédibles, ont parfois gêné ma lecture, à croire qu’aucun correcteur n’a été embauché pour ce titre. Mais dans l’ensemble, ça se lit vite et bien. Un peu trop vite, d’ailleurs ! Ce livre aurait mérité une bonne injection de liquide nutritif pour le densifier un peu, comme ce que font les usines de traitement chinoises au cabillaud norvégien. L’ajout d’une réflexion sur les SDF qui vivent dans une société à l’envers de la nôtre, et la découverte d’un mystérieux « peuple-taupe », bien qu’intéressantes, tombent souvent hors de propos et flirtent parfois avec la socio de comptoir.
L’homme est un loup pour l’homme… et surtout pour la femme.
L’idée de départ est peu originale, mais efficace. On retrouve l’idée surexploitée depuis le Dalhia Noir de la pauvre provinciale venue du fin fond de l’Ohio qui monte à New York avec ses beaux yeux bleus et cheveux blonds comme seuls bagages, dans le but de faire carrière à Broadway (ce n’est pas LA, car il y a trop de soleil : NY est un décor bien plus goth, et puis, l’auteur connaît bien cette ville). Pas de chance, elle tombe sur un salopard qui l’exploite et profite de sa détresse pour la prostituer à des gens peu recommandables. Dans l’univers impitoyable que nous dépeint l’auteur, les hommes sont tous des prédateurs en puissance, des vampires qui jouissent de dominer les femmes. Tous. Quant aux femmes, elles sont pures et innocentes, et se livrent à la « chose » en fronçant le nez, loin de se douter (les pauvres !) que leur mari se masturbe en cachette devant des pornos gonzos, car il a bien remarqué « qu’elles n’aimaient pas ça » (oui, il s’agit d’une citation). Elles-mêmes n’en regardent jamais, grands dieux ! Même des parias endurcies comme les femmes « taupes », en proie à l’appétit insatiable de leurs congénères mâles, sont prêtes à tout pour une minute d’affection. Ce postulat un rien simpliste et quelque peu zemmourien a été, paradoxalement, ce qui m’a donné envie de lire ce livre, après l’avoir vu critiqué de cette façon sur les réseaux sociaux. Une histoire bien sulfureuse, du crime et des vampires… tous les ingrédients étaient présents pour nous livrer un thriller bien juteux ! Mais je suis déçue et je reste sur ma faim. Les scènes « sulfureuses » ne le sont pas tant que ça. Les vampires n’apparaissent pas assez souvent pour faire vraiment peur, et, au final, on n’apprend pas grand-chose sur eux. Comme souvent avec le livre d’un auteur qui se vend comme le dernier aller simple pour l’Enfer le souffre paraît tiède et peu virulent. En matière de perversions (présentées ici comme le summum de l’innommable), ces « vampires » qui décrivent l’homme comme le prédateur ultime aurait bien besoin de faire un tour chez quelques auteurs femmes, justement. Je leur conseille les Infortunes de la Belle au Bois Dormant d’Anne Rice, ou un Poppy Z. Brite. Ils seraient surpris… et probablement très choqués, retournant s’enfermer à double tour dans leur cercueil. C’est peut-être ça, en fait, la fameuse « différence de nature » dont on nous rabat les oreilles tout le long du bouquin. Le manque d’imagination de certains « prédateurs » autoproclamés.